
Une nouvelle étude menée par l’Université Rice a découvert que la faune vivant à l’intérieur des zones protégées n’est pas totalement épargnée par les effets négatifs des activités humaines. L’impact négatif des activités humaines existe toujours même lorsqu’il se produit en dehors des limites protégées.
Si la récente initiative « 30 by 30 » qui est soutenue par plus de 100 nations s’avère un succès, 30 % des écosystèmes terrestres et marins de notre planète seront désignés zones protégées d’ici 2030.
Ce partenariat a été lancé afin de sauvegarder la biodiversité et d’atténuer les impacts du changement climatique.
Ces résultats pourraient éclairer les décisions politiques en matière de biodiversité que les participants de 30 x 30 pourraient prendre pour assurer le niveau maximal de protection de la biodiversité dans les zones dont ils sont responsables.
Étudier la faune dans les aires protégées
Les experts ont utilisé la plus grande enquête à long terme sur la faune par piège photographique à ce jour pour examiner l’impact des facteurs de stress anthropiques tels que la densité de la population humaine et la fragmentation de l’habitat sur 159 espèces de mammifères dans 16 aires protégées réparties dans trois régions biogéographiques.
Composé de millions d’images capturées pendant de nombreuses années à partir de 1 000 sites de pièges photographiques, l’ensemble de données a été assemblé par un réseau à grande échelle de stations de recherche acceptant de mettre en œuvre un protocole cohérent de collecte de données dans le cadre d’un partenariat entre Conservation International, le Wildlife Conservation Society et la Smithsonian Institution.
« Cet ensemble de données est tout simplement phénoménal – c’était un effort herculéen contrairement à tout ce qui avait été tenté auparavant », a déclaré la co-auteure de l’étude Lydia Beaudrot, professeure adjointe de biosciences à Rice.
Ce que les chercheurs ont appris sur la faune dans les aires protégées
L’analyse a révélé que les espèces spécialisées, qui n’occupent que des habitats spécifiques, prospèrent lorsque la fragmentation de l’habitat est faible.
Ils sont généralement plus susceptibles d’être affectés négativement par les activités humaines telles que la chasse ou l’utilisation des terres que les espèces généralistes. Ces animaux sont généralement capables de prospérer dans une plus grande variété d’environnements.
Ainsi, des spécialistes tels que le pangolin à ventre blanc du parc national impénétrable de Bwindi en Ouganda devraient se rapprocher du centre de la zone protégée, car ils sont plus susceptibles de mieux s’en tirer plus ils sont éloignés du bord.
En revanche, des espèces généralistes comme le tayra – un mammifère de la taille d’un chien de la famille des belettes qui peut vivre à la fois sous le couvert forestier et dans les prairies ou les terres cultivées – prospèrent près des limites des zones protégées. Cela est particulièrement vrai si la population humaine y est faible.
« Les habitats sont plus variés en bordure de la zone protégée », a déclaré l’auteur principal Asunción Semper-Pascual, chercheur postdoctoral en écologie et biologie de la conservation à l’Université norvégienne des sciences de la vie.
« Il y a généralement cette différence entre le couvert forestier et le paysage ouvert, comme une zone utilisée pour l’agriculture, etc. Certaines espèces généralistes prospèrent dans ce type de cadre diversifié car il donne accès à différentes ressources. »
Implications futures pour la faune vivant dans les aires protégées
Une meilleure compréhension des réponses spécifiques des espèces à divers facteurs de stress anthropiques pourrait aider à établir des priorités de conservation. Ces informations pourraient guider la gestion des aires protégées à la fois localement – en identifiant les espèces les plus vulnérables dans une région spécifique – et mondialement – en clarifiant comment les facteurs à l’échelle du paysage affectent la biodiversité au-delà des périmètres protégés.
« Nous devons penser à la situation de manière globale. La conservation fonctionnera mieux lorsqu’elle sera abordée dans des contextes spécifiques et de concert avec les personnes qui y vivent afin de créer des situations gagnant-gagnant pour les personnes et la faune », a déclaré Beaudrot.
« Au fur et à mesure que de nouvelles aires protégées sont créées, nous devons réfléchir attentivement aux facteurs à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées qui influencent la biodiversité », a conclu Semper-Pascual.
L’étude est publiée dans la revue Écologie de la nature et évolution.
En savoir plus sur les aires protégées
Les aires protégées sont des espaces géographiques définis qui sont désignés, réglementés et gérés pour atteindre des objectifs de conservation spécifiques. Ils ont été mis en place partout dans le monde avec l’objectif principal de conserver la biodiversité et de fournir un lieu où les écosystèmes peuvent prospérer et évoluer.
Les aires protégées sont classées en fonction de leurs objectifs de gestion dans le cadre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Selon l’UICN, les aires protégées sont divisées en six catégories :
Catégorie Ia – Réserve naturelle intégrale
Strictement protégé pour la biodiversité et éventuellement les caractéristiques géologiques. Les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités.
Catégorie Ib – Zone de nature sauvage
Zones vastes, non modifiées ou légèrement modifiées, conservant leur caractère et leur influence naturels, sans habitation permanente ou significative, protégées et gérées de manière à préserver leur état naturel.
Catégorie II – Parc National
De vastes zones naturelles ou quasi-naturelles mises de côté pour protéger les processus écologiques à grande échelle, qui fournissent également une base pour des opportunités spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques compatibles avec l’environnement et la culture.
Catégorie III – Monument ou élément naturel
Zones mises de côté pour protéger un monument naturel spécifique, qui peut être un relief, un mont sous-marin, une caverne sous-marine, un élément géologique, comme une grotte ou même un élément vivant comme un ancien bosquet.
Catégorie IV – Zone de gestion des habitats/espèces
Dans les zones destinées à protéger des espèces ou des habitats particuliers, des mesures de gestion seront nécessaires. Cela peut être associé à une utilisation plus large de l’environnement.
Catégorie V – Paysage paysager/marin protégé
Une zone où l’interaction des personnes et de la nature au fil du temps a produit une zone de caractère distinct avec une valeur écologique, biologique, culturelle et paysagère significative.
Catégorie VI – Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles
Zones qui conservent les écosystèmes et les habitats ainsi que les valeurs culturelles associées et les systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles. Ils sont généralement grands, avec la plupart de la zone dans un état naturel.
Ces zones peuvent varier considérablement dans leur taille, allant de minuscules parcs urbains ou réserves naturelles à de vastes parcs nationaux ou même transnationaux.
Parmi les exemples d’aires protégées, citons le parc national de Yellowstone aux États-Unis, la grande barrière de corail en Australie, la forêt amazonienne en Amérique du Sud (dont certaines parties sont protégées) et le parc national du Serengeti en Tanzanie, entre autres.
Par Andreï Ionescu, Terre.com Rédacteur personnel

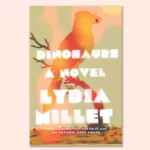












0 réponse à “Les activités humaines ont un impact négatif sur la faune vivant dans les aires protégées”